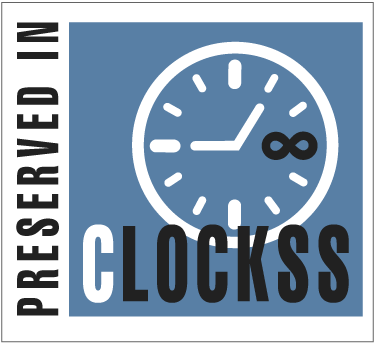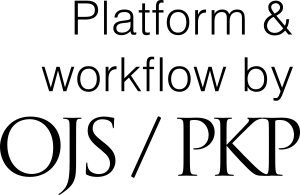Implications macroéconomiques de la corruption : Le cas de Madagascar
Mots-clés:
Corruption, Variables macroéconomiques, Madagascar, VECM, Causalité de GrangerRésumé
Ce papier tente d’analyser les effets macroéconomiques de la corruption en se basant sur des données temporelles (2002-2020) concernant Madagascar. Le modèle VAR(p) est utilisé pour explorer les relations entre l’indice de perception de la corruption et des variables macroéconomiques telles que la croissance du PIB/tête, la croissance du revenu/tête, le taux d'inflation et le taux de chômage. Toutefois, les résultats de cette analyse ne sont pas concluants. Par conséquent, les modèles VECM sont utilisés pour explorer les relations de stabilité à court et à long terme entre les variables, prenant en compte les relations de cointégration ou non entre elles. Les résultats indiquent qu'il existe une relation à long terme entre la croissance du revenu et du PIB par habitant et l'indice de perception de la corruption. Les réponses aux chocs suggèrent une relation positive entre la croissance du PIB/tête et la croissance du revenu par habitant, ainsi qu'une relation négative entre la croissance du PIB/tête et l'indice de perception de la corruption. Les variations de l'indice de perception de corruption ont un effet sur toutes les variables étudiées. Le test de causalité de Granger a montré que l'évolution positive de l'indice de corruption cause la croissance du PIB/tête, mais la causalité ne va pas dans l'autre sens. L'amélioration de la lutte contre la corruption entraîne une augmentation du revenu/tête, mais pas l'inverse.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
##submission.downloads##
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Copyright (c) 2023 Ambinintsoa RAMANAMBONONA , Jean RAZAFINDRAVONONA

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.